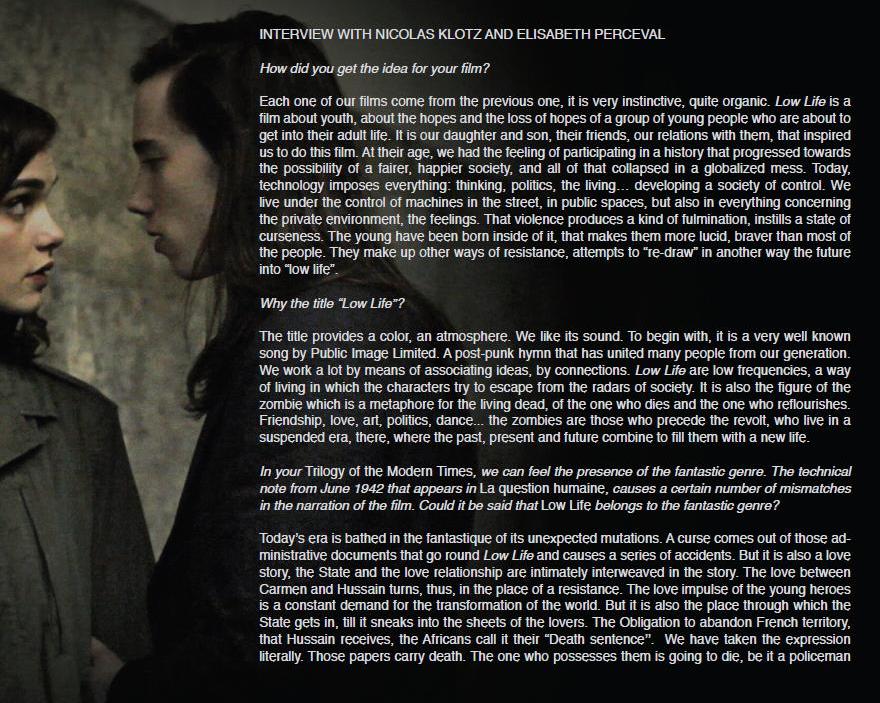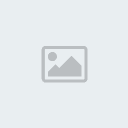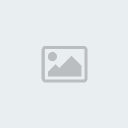Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
+5
Robert
Borges
lorinlouis
Largo
adeline
9 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5 
 Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Le film était en compétition à Locarno, il est passé dimanche, j'imagine qu'il en sera question dans les comptes rendus de ceux qui étaient là-bas.
On a publié sur le site l'entretien qu'ils nous avaient accordés :
http://www.spectresducinema.org/?p=1387
Et il existe un site dédié au film, et à leur travail de préparation sur le film. Lorin, tu connaissais ce site ?
http://www.lowlifefilm.com/
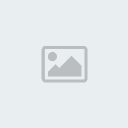
On a publié sur le site l'entretien qu'ils nous avaient accordés :
http://www.spectresducinema.org/?p=1387
Et il existe un site dédié au film, et à leur travail de préparation sur le film. Lorin, tu connaissais ce site ?
http://www.lowlifefilm.com/
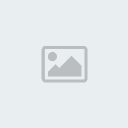
adeline- Messages : 3000
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
C'est une belle initiative...qu'on aurait peut-être pu initier nous-mêmes. 
Ca va bien avec la démarche à l'origine du film il me semble.
Sur le site des Inrocks P. Blouin parle du film un peu rapidement. Ce sont des formules type "romantisme gothique nappé de cold wave" rien de très intéressant..
Ca va bien avec la démarche à l'origine du film il me semble.
Sur le site des Inrocks P. Blouin parle du film un peu rapidement. Ce sont des formules type "romantisme gothique nappé de cold wave" rien de très intéressant..
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
'llo Largo,
à mon avis, ce site, c'est le site de la production, car il y a un espace presse. Un beau site officiel, c'est vrai, qui correspond semble-t-il vraiment au film. Enfin, aucune récompense à Locarno, c'est dommage. J'espère que le film sera bientôt distribué.
à mon avis, ce site, c'est le site de la production, car il y a un espace presse. Un beau site officiel, c'est vrai, qui correspond semble-t-il vraiment au film. Enfin, aucune récompense à Locarno, c'est dommage. J'espère que le film sera bientôt distribué.
Libé (Azoury) a écrit:Tout comme l’insurrection sert d’horizon aux jeunes gens modernes de Low Life, le nouveau film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. La révolution n’est pas leur seul mur porteur : la justice sociale (les reconduites à la frontière des sans-papiers), la poésie (partout) et l’amour (fou et menacé) les nourrissent à chaque instant. Low Life peut s’entendre comme une sorte de réponse updatée 2011 au Diable probablement, de Robert Bresson et aux Amants réguliers, de Philippe Garrel.
Il souffre de la comparaison, sans doute pour ne pas avoir réussi à faire en sorte que ses jeunes acteurs (les enthousiasmants Camille Rutherford, Arash Naimian, Luc Chessel) ne soient pas les prisonniers d’un texte très écrit (empruntant autant à Robert Walser qu’à Alain Badiou). Mais le film s’échappe enfin en faisant surgir une ligne qui n‘appartient qu’au cinéma de Klotz et Perceval : celle de la magie noire. Ses séquences vaudoues abritent une croyance unique dans le cinéma.
adeline- Messages : 3000
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Bin dans la présentation ils disent que le sitr est réalisé par l'équipe de la revue Lumiere mais qu'il servira aussi pour la promo. A voir comment ils vont l'enrichir mais ça parait ylun peu différent d'un simple site officiel qui se résume en général à pas grand chose d'intéressant.
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Ah oui, tu as raison, c'est cette revue espagnole qui semble s'occuper du site :
http://www.elumiere.net/lumiere_web.html
J'avais déjà fait un lien vers cette revue à propos d'un article d'un film du FID, je ne me souviens plus du tout duquel. Mais la plupart des textes sont en espagnol. En tous cas, c'est un boulot impressionnant.
http://www.elumiere.net/lumiere_web.html
J'avais déjà fait un lien vers cette revue à propos d'un article d'un film du FID, je ne me souviens plus du tout duquel. Mais la plupart des textes sont en espagnol. En tous cas, c'est un boulot impressionnant.
adeline- Messages : 3000
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Oui, Adeline, N. Klotz m'en a parlé dans un mail. C'est un site développé conjointement avec la revue Lumière pour la présentation du film. Il est très bien monté, assez remarquable, je trouve, et recoupe ce qui a été réalisé dans les colonnes de notre revue, l'année dernière. Ça donne envie de trépigner d'impatience en attendant la sortie en salles, prévue pour début 2012, semble-t-il.
Sinon, entre-temps, le film suit son petit bonhomme de sélections officielles -Sélections en 3 semaines à Toronto, Nouveau Cinéma de Montréal, Vancouver, Londres, Sao Paulo, Gijon, French Cinema Week de New-York, Abou Dabi, Tokyo Unifrance, Buénos Aires, Vienne... (si on y trouve des correspondants... )- et si la déception de Locarno est réelle, cette présence festivalière augure d'une œuvre vivement intéressante.
)- et si la déception de Locarno est réelle, cette présence festivalière augure d'une œuvre vivement intéressante.
A voir. A suivre du plus près possible.
Sinon, entre-temps, le film suit son petit bonhomme de sélections officielles -Sélections en 3 semaines à Toronto, Nouveau Cinéma de Montréal, Vancouver, Londres, Sao Paulo, Gijon, French Cinema Week de New-York, Abou Dabi, Tokyo Unifrance, Buénos Aires, Vienne... (si on y trouve des correspondants...
A voir. A suivre du plus près possible.

lorinlouis- Messages : 1691
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
CR des Inrocks sur la présence du film à Locarno
Autre qualificatif plus loin, de "dandysme dark". En même temps, c'est les Inrocks...
Cette année, cependant, durant le festival, on attendait surtout beaucoup du fameux sous-genre "français-politique" avec les films de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, Low Life, et de Rabah Ameur-Zaïmeche, Les Chants de Mandrin. Et la notion de genre s'impose ici d'autant plus facilement que les deux films racontent quasiment la même histoire: il y a aujourd'hui en France une guerre civile qui oppose une population marginale et immigrée à la police de la bourgeoisie. Le conte gothique qu'en tirent les Klotzeval (sic) [une jeune bourgeoise activiste et un poète afghan menacé d'expulsion s'enferment dans une chambre pour échapper au monde] a plutôt déçu ses admirateurs habituels. Et il est vrai que le romantisme noir et nihiliste, entièrement nappé de cold wave, l'emporte ici clairement sur l'analyse politique.
On peut trouver, cependant, plus d'étrangeté fictionnelle à ce portrait d'enfants du siècle qu'aux traités plus démonstratifs qui l'ont précédé.
Autre qualificatif plus loin, de "dandysme dark". En même temps, c'est les Inrocks...


lorinlouis- Messages : 1691
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Je suis à Rolle
Par Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval
Je suis à Rolle pour mixer le film que je viens de faire au Festival d’Avignon sur Mlle Julie pour France Télévisions, avec François Musy.
C’est curieux, c’est ici que nous voulions mixer Low Life. Dans l’auditorium de François, où il travaille depuis trente ans avec Jean-Luc Godard. Curieux que ça soit grâce à la télévision et non au cinéma que je peux travailler ici. Nous avons essayé pendant des mois. Impossible. Les contraintes administratives font que c’est impossible, même si ce choix, celui du mixeur, de l’auditorium, détermine tout l’univers sonore du film. Même pour un film qui ne paye pas de mine avec son financement de 1.350.000 euros. Quand on voit l’intelligence et la clarté artisanale de cet auditorium, les conditions d’écoute et de travail, sa vie quotidienne, ses archives, installés dans ce qui était le garage du bureau de Godard, on sent que l’Histoire du Cinéma est encore très vivace. Et qu’il faut des lieux pour ça, des murs dans lesquels on peut travailler. Quatre murs, ce n’est pas toujours une prison. Quatre murs, ça peut être une salle de cinéma, une chambre dans laquelle on va tourner, ou un site internet abritant un film. Le pari que nous faisons, celui qu’il faut faire, pas seulement pour l’avenir du cinéma, mais pour l’avenir tout court, c’est d’affirmer que l’écriture est plus forte que ce qui éteint l’écriture. L´Association Lumière, qui a conçu et réalisé ce site, est une revue électronique naissante. Ils sont une vingtaine de jeunes gens, vivant à Barcelone, Séville, Paris… nous ne les connaissons pas tous. Nous avons rencontrés quelques uns, dans des salles de projection puis dans des cafés à Barcelone. Ils nous ont donné un tirage papier du numéro qui venait de sortir - Internationale Godard. 140 pages. Sans financement. L’écriture est plus forte que ce qui éteint l’écriture. Une des questions au cœur de leur travail est celle de la cinéphilie, depuis leur génération. Que faire avec la cinéphilie ? C’est une question à laquelle beaucoup de personnes au-dessus de 50 ans ont répondu, souvent assez tristement. Ce travail électronique, entremêle des textes, des films, des entretiens, des archives, des musiques. L’idée est de créer quatre murs entre lesquelles il est possible d’expérimenter directement, organiquement, les matériaux au travail dans Low Life.
Un site qui prolonge, avec d’autres, le travail de cinéma que nous faisons depuis une dizaine d’années maintenant. Ce n’est pas un site directement promotionnel, bien qu’il aura également indirectement cette fonction-là. Nous avons décidé de fonder ce site lorsque Low Life a été sélectionné par le Festival de Locarno. Nous retrouvant alors sans dossier de presse, sans affiches, sans supports pour la presse et le public, lors d’un voyage à Barcelone, dialoguant avec les Lumières nous avons discuté de la possibilité d’inventer quelque chose de nouveau.
On pourrait dire que cette sélection est son acte fondateur. Une deuxième étape est prévue après Locarno, en trois langues - français, espagnol et anglais - jusqu’à la sortie nationale et internationale du film. C’est donc un pari fort que nous faisons avec Lumière. Ce qui se passait hier dans les salles de cinéma, les cafés, les revues, se passe aujourd’hui sur internet. Avec ce travail, Lumière est en train d’inventer un nouvel horizon au cinéma.
Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval
Juillet 2011

lorinlouis- Messages : 1691
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Donc Mediapart, compte-rendu de Locarno :
Les «nuits noires» de Locarno
15 août 2011 | Par Ludovic Lamant
On est rentrés rassasiés du festival de cinéma de Locarno, trait d'union helvète entre Cannes (en mai) et Venise (en septembre), clos le 14 août. La deuxième édition proposée par le Français Olivier Père s'est épanouie dans un éclectisme délicieux, entre blockbusters américains (Cowboys et envahisseurs, Superet radicalité catalane (deux films d'Albert Serra), intégrale Minnelli et armada française (pas moins de cinq films au fil des deux compétitions, en plus de la présence d'Isabelle Huppert et Gérard Depardieu).
Et plus le festival ouvrait les tiroirs, et multipliait les entrées, plus une ligne de fond s'imposait. Au moment où des émeutes secouaient la Grande-Bretagne, et les Etats-Unis perdaient leur note suprême sur les marchés financiers, Locarno a décrit, cette année, un monde au bord du gouffre. Depuis cette petite ville chic de Suisse italienne, en bord de lac paisible, on a pensé la catastrophe, et les moyens d'y échapper. On a aiguisé nos armes.
Hashoter, de l'Israélien Nadav Lapid, imagine une bande d'activistes révoltés contre les inégalités qui rongent Tel-Aviv aujourd'hui. Les Chants de Mandrin, du Français Rabah Ameur-Zaïmeche, suit le quotidien de contrebandiers héroïques dans la France du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution. Dans El Estudiante, de l'Argentin Santiago Mitre, un militant finit par dire «non» aux magouilles, passe-droits et fausses promesses qui plombent le milieu universitaire à Buenos Aires. Quant à Fernand Melgar, son Vol spécial documente les conditions de détention d'étrangers qui se sont vu refuser, en Suisse, leur demande d'asile, et attendent l'avion du retour.
Une ambiance de fin de règne et de ruines, que Low Life, film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, présenté en compétition internationale, mais oublié du palmarès (lire sous l'onglet Prolonger), a sans doute restitué avec le plus de puissance. Les lecteurs attentifs de Mediapart s'en souviennent peut-être: le quatrième long métrage du couple Klotz/Perceval (après, entre autres, La Blessure et La Question humaine), est en chantier sur le site, depuis 2008 (on lira ici un texte de préparation, au moment de l'écriture du scénario, un portrait de l'un des comédiens principaux, ou encore, là, un reportage sur le tournage, à Tours).
A l'image des trous noirs qui s'emparent par instants de l'écran, Low Life, récit d'une passion amoureuse impossible, entre une activiste française et un sans-papiers afghan menacé d'expulsion, est un film travaillé par l'obscurité. Un film de nuit, comme il y a des oiseaux de nuit, majestueux et difficiles à approcher. Le temps du film est calé sur l'avancée de cette nuit noire et politique, tout à la fois territoire du complot (pour inventer les révoltes à venir) et royaume du sommeil (pour reprendre ses forces, retrouver son souffle). On y avance pieds nus, les chaussures à la main, au bord du gouffre.
Magie noire
Parmi les personnages les plus stupéfiants du film, Julio est un adolescent originaire d'Haïti. Sans-papiers, il vient de subir un examen à l'hôpital, qui lui aurait appris qu'il est deux ans plus vieux que ce que prétend son certificat de naissance. Pétrifié par cette nouvelle, incapable de quitter le lit, il lâche, convaincu d'avoir été envoûté lors de son séjour à l'hôpital: «Cela m'a fait comme un incendie dans la tête.» Des éclats de lumière dans l'obscurité.
Low Life circule entre les feux et les ténèbres, entre le délabrement et l'utopie, entre la destruction et le devenir. C'est un portrait d'une génération née «dans la catastrophe», et qui tente de résister. De construire ce low life, ce «monde sensible, heureux, où tous les hommes dorment dans l'égalité du même sommeil». «On en reviendra aux nuits noires», promet Djamel (Michael Evans), l'un des meneurs du groupe, sans que ses amis y croient tout à fait.
Au cœur de ces ténèbres s'arme une guerre civile, qui fait basculer le film en terrains fantastiques. Une «guérilla vaudou», selon les mots de Klotz et Perceval, où des jeunes, victimes de décisions administratives qu'ils refusent, s'affrontent avec la police, en leur lançant des «forces de mort». Malédictions, sorts et rituels vaudous, le film tend une hypothèse passionnante, à la veille d'un scrutin présidentiel en France, et qui poursuit le spectateur bien après la projection: la politique agirait comme de la magie noire, et l'on discourrait en politique comme l'on jette des sorts. Par exemple en stigmatisant des étrangers.
Bien sûr, les réalisateurs ont choisi leur camp, et filment ces révoltés comme des héros. Voir les contre-plongées qui magnifient ces vaincus de l'Histoire. Voir les incessants déplacements des personnages que la caméra épouse irrésistiblement. Ecouter, aussi, les mots qu'ils prononcent: leur langue, sombre et littéraire, que l'on n'attend pas forcément dans la bouche de ces jeunes activistes, est l'une des merveilles de ce long métrage («Tirer les choses de l'habitude, les déchloroformer», écrivait Bresson dans ses Notes...).
Low Life tente ainsi de prendre le relais d'autres films marquants sur la jeunesse, du Diable probablement (1977) de Bresson (l'un des personnages clés de Low Life ressuscite explicitement le Charles révolté du film de Bresson, qui se suicidait), aux Amants réguliers (2004) de Philippe Garrel, passant par les films de Jacques Tourneur (dont La Féline, en 1942, pour le fantastique et le retour des morts). Au terme d'un final émouvant, on ignore si les personnages parviendront à fabriquer pour de vrai l'utopie qui les habite. Mais à défaut, Low Life, le film, dessine pour le spectateur un territoire neuf et risqué, tourné en numérique, dont chacun peut/doit s'emparer. Pour patienter avant la sortie en salles, un site mêlant entretiens, vidéos et montages critiques, vient d'être lancé.
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Précédents textes de Mediapart autour de la préparation du film :
Aux côtés de Nicolas Klotz, en quête du «cinéma qui vient»
31 janvier 2010 | Par Ludovic Lamant
A la sortie en salles du Diable probablement, en 1977, Robert Bresson a, dit-on, poussé ce cri : «Ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est le gâchis qu'on a fait de tout. C'est cette civilisation de masse où bientôt l'individu n'existera plus. Cette immense entreprise de démolition où nous périrons par où nous avons cru vivre.» A l'écran, le quotidien d'une bande de jeunes militants en révolte, écolos dans un après-Mai 68 incertain. Surtout, il y a Charles (Antoine Monnier), qui se sent «coupable sans l'être», ne voit plus «l'issue», se détache du groupe et se tue. Un suicide, ou presque : c'est la nuit au cimetière du Père-Lachaise, et un ami, junkie, à sa demande, l'assassine. Une balle puis deux autres. Dans le dos. Fin.
Charles va ressusciter dans les mois à venir. Il sera l'un des personnages principaux du prochain film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval – une œuvre encore en travaux, bientôt en tournage, et dont la fabrication, expérience inédite au sein d'une industrie du cinéma d'habitude frileuse à ce genre d'expérimentations, est grande ouverte au public. Elizabeth Perceval confirme : «Cela nous travaillait depuis longtemps de faire un film où Charles ressusciterait.» Celui qui incarnera l'adolescent désespéré s'appelle Baptiste Debicki, inscrit au département réalisation à la Fémis, l'école de cinéma de la rue Francœur à Paris. Il est brun, pas très vieux, pas très grand, pas très attiré par la comédie non plus. En tout cas c'est ce qu'il dit.
Il espère surtout profiter du tournage qui se profile pour «espionner Nicolas», observer au plus près le réalisateur au travail. Lorsqu'il a fallu, en juin dernier, qu'il participe à une lecture des premières pages du scénario de Low Life, au cinéma Kosmos de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), il s'est plié à l'exercice poliment. Sans trop forcer. A peine si la cinquantaine de spectateurs l'entendait. Quelque chose de ces marmonnements indéchiffrables des ados de Gus Van Sant. Il y a pire comme début.
Dans les premiers moments du film à venir, Charles forme un couple avec Carmen, thésarde à Lyon, qui s'éprendra d'un autre, le bel Hussain, sans-papiers afghan, étudiant en fac de lettres. Il se pourrait bien qu'une fois encore, Charles ne termine pas le film vivant. Que l'histoire se répète. Que son fantôme hante l'amour de Carmen et Hussain. A moins que cela ne devienne plus compliqué. Low Life, qui devrait se tourner au printemps prochain entre Lyon et la banlieue parisienne, est un film sur la jeunesse et l'engagement des corps, un de plus pour ses auteurs, après La Blessure (2004) et La Question humaine (2007). Un «film depuis la jeunesse», avance Nicolas Klotz, comme s'il s'agissait, pour son sixième long métrage, de choisir son camp.
La salle-laboratoire
Depuis près d'un an, Low Life a donc ouvert son chantier au public. Klotz et Perceval font du cinéma à ciel ouvert, prolongeant une démarche qu'ils avaient enclenchée pour la fabrication de La Question humaine. Les futurs spectateurs peuvent venir voir, s'approcher, toucher, participer. Il n'y a pas encore de film à montrer. A la place, une série de «dialogues clandestins» dans des salles, ponctués de projections de fragments en tout genre (courts métrages, répétitions filmées, lettres d'intention mises en image, etc.), au cours desquels se charge le film à faire.
La figure de l'auteur démiurge en prend un coup. Une communauté se forme autour du couple cinéaste, entouré de philosophes et sociologues, critiques et journalistes, comédiens et spectateurs lambda. Ce n'est plus le cinéma collectif façon Medvedkine, Dziga Vertov ou Loin du Vietnam. Les temps ont changé – même Godard n'est plus le même. C'est une expérience de gravitation, inégale mais absolument neuve, où l'œuvre à venir se nourrit des prises de position affirmées au fil des mois avec de plus en plus de justesse.
Exemple de ces satellites porte-bonheur autour de Low Life pas encore sur pied : le film de Santiago Fillol, critique catalan, intitulé Dormez-vous?. Après lecture d'une des premières versions du scénario, l'Espagnol, qui suit de près le travail de Klotz/Perceval depuis des années, a composé une lettre filmée d'une petite heure, lue par la future héroïne du long métrage, Judith Chemla, et adressée aux réalisateurs. «Je m'appelle Carmen. Je ne suis pas encore née. (...) Nicolas [Klotz], Elisabeth [Perceval], quel sera mon visage ?» Plus loin : «Il faudra envoûter les mots.» A l'écran, un enchevêtrement de séquences déjà tournées par Klotz (La Blessure) et autres références assumées pour le film à venir (Le Diable probablement, donc, mais aussi White Zombie, de Victor Halperin, Dracula, de Tod Browning, etc.). Avec ce «montage d'appropriation», Fillol invente l'anti-bande-annonce : au résumé du film déjà fait, qui enserre, remâche et déflore, il préfère les pistes à tester, les fausses routes et les énigmes d'avant tournage, stimulantes parce que tout y est encore à l'état de possible.
«Une fois tourné, le film sera pris dans un engrenage commercial et critique. D'où ce travail public en amont, avec l'idée qu'une salle de cinéma, autant qu'un plateau de tournage ou une salle de montage, met en mouvement des choses», expliquait, le 30 juin au cinéma Jacques Prévert de Gonesse, Nicolas Klotz, devant une trentaine de curieux (on n'ose pas écrire spectateurs) assez désarçonnés par l'absence de film pour cette séance. Une série de six premiers débats se sont déroulés en juin 2009, à l'initiative d'un réseau de salles de cinéma indépendantes en Ile-de-France (l'ACRIF), reliant, pour le dire vite, les Ulis à Saint-Ouen.
«Avatar»/«Low Life»
En creux, un espoir : que la fabrique du cinéma de demain s'accompagne d'une réinvention de l'action culturelle. Ce même soir à Gonesse, le sociologue Eric Fassin, invité pour l'occasion, résumait ainsi les choses : «Cette démarche ne présuppose pas qu'il existe un public, mais essaie au contraire de le construire, pour que chacun s'approprie le film.» On n'est pas très loin des expérimentations envoûtantes, côté scènes, d'un Pascal Rambert, directeur du théâtre de Gennevilliers depuis 2007, qui ne cesse de réfléchir aux passerelles entre professionnels, amateurs et intellectuels.
A l'heure d'Avatar et du cinéma en relief, réponse hollywoodienne au piratage des films sur internet, la fabrication de Low life ouvre d'autres sentiers, plus discrets et difficiles à emprunter, face au risque de désertion de la salle de cinéma. Aux projecteurs agressifs de la superproduction façon James Cameron, Klotz cultive les signaux faibles, la lumière des lucioles, pour parler comme le philosophe Georges Didi-Huberman, l'un des parrains discrets de l'aventure.
Pourtant, Avatar et Low Life ont plus de points communs qu'il n'y paraît. D'abord parce que le cinéaste de La Blessure lui aussi intègre les avancées techniques à son travail quotidien – à commencer par l'utilisation systématique de la DV, ces caméras miniatures avec lesquelles il enregistre les répétitions de ses comédiens et multiplie les fragments filmés. Manière d'appliquer à la lettre cette maxime d'un autre réalisateur, portugais celui-là, Pedro Costa (dont le dernier long métrage, Ne change rien, vient de sortir en salles) : «Il faut travailler tous les jours.» Des exercices quotidiens, DV au poing, sans relâche, pour sans cesse approfondir son désir de cinéma. De l'archivage spontané du travail en cours, pour garder une mémoire du projet depuis ses origines. Une matière filmée complémentaire au sacro-saint scénario, pour se préparer au tournage.
Ensuite et surtout parce que le prochain film de Klotz et Perceval creusera la figure du zombie, un grand classique au cinéma, annoncé cette fois comme l'envers sombre des avatars de Cameron. Autant l'avatar américain est une figure saturée, autant le zombie des Klotz/Perceval sera tout en creux, insaisissable, perturbant. Des corps présents, sans être représentés, promettent-ils. Mais encore ? Il y avait cette phrase, de Nicolas Klotz, un soir de juin, comme une invite à une lecture frontale : «Nous vivons une époque où le réel est opacifié par des méthodes de communication et d'envoûtement.»
Zombies, fantômes et dibouks
18 décembre 2009, au CentQuatre à Paris : projection, pour y voir plus clair, de Zombies, un travail réalisé avec une dizaine de comédiens, pendant un mois, à Toulouse, fin 2008, à l'invite des Chantiers nomades. Une «chorale de textes» autour des nouvelles figures de la révolte (Pasolini, Sebald, etc.), tournée en quatre nuits. Klotz filme des hommes et des femmes dans les rues de la ville, visages déformés par l'obscurité, corps possédés contre des murs de pierres, murmurant des phrases face caméra, bouches entrouvertes, à peine (on pense parfois à la Jeanne Balibar, créature nocturne et parfois effrayante du dernier Pedro Costa, justement).
«Zombies» «Zombies»
Face à cette galerie de portraits terrifiants, comme des sculptures habitées, «les visages sont plus importants que les textes», prévient Klotz. Présent ce soir-là, Georges Didi-Huberman réagit au film en creusant les relations qui ne datent pas d'hier, entre cinéma et théâtre, mais s'avoue plus sceptique sur cette affaire de zombies. «Je n'ai pas compris», reconnaît-il. S'ensuit un débat sur les types de monstres que chacun pense avoir reconnu à l'écran – des fantômes ? des dibouks ? Discret écho aux récentes polémiques sur la monstruosité de la France de Sarkozy, l'entreprise Low Life avance... Les monstres prennent corps.
Alors bien sûr, l'expérience n'a pas toujours été aussi fertile. Elle repose même sur un certain nombre de paris parfois difficiles à assumer. «On sait bien que l'acte de création n'est pas démocratique», a ainsi glissé Gilles Sandoz, producteur courageux (de Low Life notamment), lors d'une séance fin juin au Jean Vigo de Gennevilliers. Mirage de la démocratisation du processus créatif ? Dissipation des mystères du film avant même qu'il n'existe sur écran, à trop vouloir exposer en amont les intentions des réalisateurs ? Approche trop théorique d'une expérience d'abord sensible, le cinéma ? Voire pire : éloge collectif et obligatoire de l'œuvre encore à venir ? Ce sont des risques à prendre, face auxquels le couple Klotz/Perceval s'est parfois trouvé démuni. C'est grave ? Non, du tout. C'est un apprentissage. Du cinéma en construction, ouvert, à plusieurs mains. Cela prend du temps et cogne par endroits. Tant mieux.
Iran: le fils par qui la libération est arrivée
16 août 2009 | Par Ludovic Lamant
Sa première année en France, il l'a passée muet. En intrus, parmi les étudiants de la fac de cinéma de Paris-8. A l'époque, Arash Naiman, pas très sûr de son français, pas très à l'aise dans la capitale, envisage de retourner à Téhéran. C'était en 2007. A l'été 2009, l'homme est toujours à Paris, où il enchaîne les entretiens avec la presse. Il n'a peut-être jamais autant parlé. Radios, journaux, télés, internet. «J'avais six ou sept phrases en tête, et j'ai répété les six ou sept phrases 700 fois», confie-t-il.
Arash Naiman, 26 ans, est le fils unique de Nazak Afshar, cette employée franco-iranienne du service culturel de l'ambassade de France en Iran, emprisonnée le 6 août, jugée le 8, libérée le 11. Téhéran l'accuse d'avoir ouvert les portes de l'ambassade à des manifestants blessés, lors des protestations consécutives à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad en juin. Elle a dû mettre son appartement sous caution pour sortir de prison. «Je n'ai pas voulu entrer dans le jeu de ne pas parler», avance Arash, pour justifier son entrain à répondre aux questions, toujours les mêmes, des journalistes français. A Téhéran, les avocats de Nazak Afshar lui avaient pourtant demandé de se taire.
Depuis l'arrestation de sa mère, le fils s'est remis à fumer. Il dit qu'il n'a jamais pleuré ces derniers jours, pas «craqué» une seule fois, qu'il n'en avait pas le temps. Il assure qu'il n'a pas bu une seule goutte d'alcool, qu'il faut rester sobre pendant la traversée du tunnel. Il a passé un coup de fil à son père qu'il voit peu, installé aux Etats-Unis depuis 22 ans, pour le prévenir des événements. Et affirme avoir ri, le samedi 15 août, en découvrant les images du procès sur internet. «C'était un tribunal révolutionnaire tellement ridicule, que cela en devenait rigolo». Sur le banc des accusés, sa mère, au visage «horrible», enserrée dans un tchador de prisonnière. Les photos d'elle prises ce jour-là ne lui ressemblent pas, c'est en tout cas ce qu'il veut croire. Trois jours plus tard, Arash a parlé à Nazak libérée, quelques minutes par téléphone, pour lui expliquer que cette «expérience», la prison, l'avait «grandie». Arash ne dit pas ce que sa mère a répondu. D'après des proches à Téhéran, elle est pâle et exténuée. Elle a fêté le 14 août ses 50 ans.
Bientôt à l'écran
Sa médiatisation a valu à Arash Naiman un titre qu'il récite d'un coup d'un seul, celui de président du «Comité indépendant contre la répression des citoyens iraniens». Depuis le scrutin contesté du 12 juin, Arash, qui veut devenir cinéaste, est de toutes les marches parisiennes de soutien aux opposants. Et à ceux qui aujourd'hui lui parleraient trop de sa mère, il rappelle qu'«il y a aussi beaucoup de personnes inconnues, des centaines, qui ont été arrêtées et jugées à Téhéran». Des cas de torture en prison des militants réformistes sont désormais avérés. «La prison d'Evin à Téhéran, dans ma tête, c'est Alcatraz», lâche-t-il.
Arash Naiman, au printemps 2009.© Nicolas Klotz.
Au-delà du durcissement d'un régime contesté, les mobilisations de la société civile depuis près de deux mois l'ont réconcilié avec l'Iran. «Avant les élections, je croyais que seule une minorité pensait comme moi. Mais c'est faux. Je pense comme trois millions de personnes à Téhéran. Je suis athée depuis mes quinze ans. On n'est pas tous athées. Mais l'on peut à présent parler ensemble. Et désormais je peux dire que j'aime les Iraniens.»
Avant l'arrestation, la mère et le fils se parlaient longuement, une fois par semaine, via le réseau Skype. «Par précaution, nous avions développé une langue secrète, inaccessible aux autres. Un mélange de farsi, d'anglais, de français et d'azéri», explique-t-il. Elle lui racontait ses entrevues glaçantes et régulières avec des officiels du ministère du renseignement et de la sécurité depuis un an, et ses hésitations à le rejoindre en France. Il lui décrivait les mobilisations de soutien à Paris, et les avancées d'un projet qui lui est cher, le tournage d'un film, au printemps prochain, dont il tiendra le premier rôle.
«Cela ne va pas durer»
Arash sera Hussain, un sans-papiers afghan, installé à Lyon depuis quatre ans, poète et fan de Friedrich Hölderlin. Hussain tombe amoureux transi d'une Française, Carmen, et s'installe chez elle, avant de recevoir une lettre d'expulsion du territoire. Pour éviter l'arrestation, le couple se séquestre dans sa propre chambre. Le film, Low Life, en chantier sur Mediapart, sera signé Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval (La Blessure, La Question humaine).
«Avec ce qu'il s'est passé depuis deux mois, il existe une connexion entre Hussain et moi. C'est un lien que je n'ai pas choisi, cela s'est imposé», avance Arash. Démocratisation de l'Iran, arrêt des expulsions d'étrangers du territoire français, équivalence des luttes? Convergence des terreaux militants ? Le futur acteur esquive. Il voit deux points communs entre lui et ce double à l'écran encore imaginaire. La poésie et l'exil. Car Arash, militant déraciné, ne parle que d'allers-retours. Et donne ses rendez-vous au «Nord-Sud», une brasserie du XVIIIe arrondissement de Paris. Il vient d'Iran (naissance à Téhéran en 1983), a vécu à plusieurs reprises aux Etats-Unis (1994, 1995, 1997, 2003), étudie en France depuis 2007. Franco-iranien (il a obtenu la double nationalité en même temps que sa mère, remerciée pour ses 15 ans de services à l'ambassade), Arash Naiman jouera donc un Afghan à l'écran. Une naturalisation qui n'a pas l'air de le perturber.
D'après ce que l'on a lu, Low Life ne terminera pas très bien. Et la révolte iranienne? L'étudiant y croit. «Il y a ce proverbe russe selon lequel un optimiste est un pessimiste mal informé. Je suis encore mal informé... Je pense que le coup d'Etat d'Ahmadinejad, si l'on peut appeler cela comme ça, ne va pas durer.» Il voit dans l'arrestation de sa mère, et sa libération à peine cinq jours plus tard, une preuve supplémentaire des errements d'un régime mal en point. Optimiste. Dans le scénario du film écrit par Elisabeth Perceval, on avait surligné cette phrase prononcée par Hussain, et forcément, on s'était dit qu'elle devait coller à merveille à Arash en ces temps incertains: «Depuis que je suis là, je ne fais que des cauchemars.» Faux. Le fils dort, de mieux en mieux, merci pour lui. Les insomnies ne le harcèlent plus. Il se rêve en Spiderman la nuit. C'est peut-être un indice, pour qui serait curieux des contours du premier film qu'Arash Naiman réalisera, dans les années à venir – surtout pas en Iran.
]b]Nicolas Klotz souffle sur les braises de la révolte[/b]
16 janvier 2011 | Par Ludovic Lamant
Camille Rutherford joue Carmen.© Nicolas Klotz.
Nicolas Klotz s'allonge sur la moquette grise, se relève, s'affale à nouveau. Le réalisateur montre des poses aux jeunes figurants, la vingtaine pas plus, qui s'exécutent docilement. Il sort du plateau, repasse devant la caméra. «Si la position du corps est juste, le reste suivra», glisse-t-il avant une prise. A terre, entre les arrondis des corps affalés, des bougies, des canettes de bières et des cendriers presque pleins: la soirée touche à sa fin, c'est déjà le petit matin au dehors. On s'embrasse ici ou là, on se chuchote à l'oreille des mots doux. A moins que ce ne soit une conspiration qui se prépare – les murmures d'une révolte?
Au fond de la salle, contre la cheminée, il y a Carmen (Camille Rutherford), entrée dans un «coma amoureux» depuis qu'elle a rencontré Hussain (Arash Naimian), étudiant en lettres, sans-papiers afghan, sous le coup d'une expulsion du territoire – nous sommes dans la France nauséeuse des années 2000, celle des cinq lois sur l'immigration votées en six ans, des surenchères sécuritaires et du débat sur l'«identité nationale», celle dont on ne voit pas très bien par où sortir, ni comment s'en débarrasser.
En cette fin novembre, le tournage des Amants de Low Life, dont Mediapart suit la fabrication depuis 2008, est quasi bouclé. A observer les quatre prises réalisées pour cette scène, et l'entremêlement des corps las et grisés, on pense, au risque de la référence plombante, aux soldats endormis d'un classique de Piero della Francesca, la Résurrection (1463), eux aussi éclairés par l'aube qui se devine au fond, eux aussi pris dans des positions impossibles, eux aussi devenus complices au fil de la nuit passée.
Dans le film, à défaut de soldats, il y aura des «combattants»: des militants gorgés de jeunesse, venus de RESF et d'ailleurs, révoltés contre une époque qui prend l'eau de tous les côtés. Leur meneur, Djamel (Michael Evans), traîne sur le plateau son élégance et ses tourments solaires. Extrait d'un dialogue à trois, tourné au petit matin, récit halluciné des batailles et des monstruosités de la nuit passée, en compagnie de morts vivants qui surgissent au détour d'un couloir:
Julie: Tu étais là? Je t'ai pas vu entrer... Oui, plein, des cadavres partout.
Djamel: Tu aurais dû venir, c'était grandiose, je te raconterai. T'es pâle, qu'est-ce qu'il t'arrive?
Charles: J'étais mort, je me suis relevé, et je suis là, tu vois.
Sous l'œil de Christian Estrosi[i]
Luc Chessel joue Charles.© Nicolas Klotz.
Pour filmer les combats, l'unique caméra est un appareil photo – un Canon 1D H264. Avantage du dispositif, de plus en plus prisé: il combine le tournage en numérique, qui, parfois, tend à écraser l'espace, avec une vraie profondeur de champ. Surtout, ces boîtiers sont hypersensibles à la lumière. «A l'écran, une ampoule devient un projecteur», explique un membre de l'équipe. Il suffit de quelques bougies pour éclairer cette scène du matin, preuve que le cinéma, pour ceux qui en doutaient, n'est pas une affaire si compliquée...
La vieille bâtisse qui héberge le tournage, en plein centre de Tours, est à l'image du film à venir: ouverte aux courants d'air et, surtout, grouillante de corps à tous les étages, de la cuisine aux salons. De jeunes comédiens beaux et inconnus, dont c'est pour beaucoup la première expérience. «Ils sont entrés dans notre combat», dit d'eux Elisabeth Perceval, auteure du scénario et co-réalisatrice du film. Allusion, au-delà du sujet des Amants de Low Life, aux conditions de travail de l'équipe, assez épiques, comme c'est désormais la loi pour beaucoup de films français aux budgets serrés (on est dans la fourchette basse des fameux films du milieu chers à Pascale Ferran).
Prévu au départ sur plus de deux mois, le tournage a été ramené à six semaines, restrictions budgétaires obligent. Sauf que le scénario, lui, n'a pas bougé. Les quotas d'heures supplémentaires ont vite explosé. Le film, pour ne rien faciliter, s'est tourné dans un désordre à peu près complet. Trois semaines de scènes en extérieur, souvent la nuit, dans le centre de Lyon (au moment, jolie coïncidence pour un film aimanté par la jeunesse, des manifestations musclées contre la réforme des retraites). Auxquelles ont fait suite trois semaines à Tours, consacrées aux scènes d'intérieur et d'intimité.
Pour ne pas se perdre dans l'architecture du film à venir, un plan des Amants de Low Life a été dressé, sur un mur entier du rez-de-chaussée: un assemblage de photos aux formats divers, dispersées sur du papier canson, où chaque image renvoie à une scène déjà tournée. En vrac, on reconnaît des comédiens en répétition (des polaroïds de Nicolas Klotz, souvent développés sur de la pellicule périmée), mais aussi des lieux d'inspiration (Séville, la nuit) ou de la matière brute, documentaire (Christian Estrosi et des écrans de surveillance). Ce roman photo grand ouvert est la matière du film en cours.
«Un travelling, c'est un trait»
En cette fin novembre, Klotz et Perceval tournent vite, trois quatre prises pas beaucoup plus, peut-être à cause de la fatigue de fin de tournage, mais pas seulement: «Il y a eu des mois de répétition en amont, et je ne veux pas user les comédiens. Je déteste dépasser les trois prises. Les choses n'arrivent qu'une fois dans la vie, et cela n'arrive qu'une fois dans un plan. Si l'on insiste, on se répète, on ne se repose plus que sur le métier», avance Nicolas Klotz. Le couple Klotz/Perceval signe ici sa cinquième collaboration sur un long métrage, et sans doute la plus attendue, après le succès critique et public de La Question humaine (2007), avec un casting autrement plus mûr, Mathieu Amalric et Michael Lonsdale.
«La Question humaine fonctionnait sur des champs/contre-champs. Cette fois, nous avons tourné beaucoup de travellings. Ce sera un film plus libre, plus romanesque. Un travelling, c'est un trait», précise le réalisateur. Confirmation de ces élans plastiques, dans la soirée, lorsque l'équipe, qui en est à sa quatrième scène de la journée, filme Carmen, aux alentours de 21 heures, apparaître au fond d'un couloir, puis longer les fenêtres d'une pièce plongée dans le noir. Camille Rutherford a traversé les scènes de la journée avec l'air égaré des comédiennes du cinéma muet américain – Klotz aime les actrices sorties de nulle part et assez sublimes, des films de Frank Borzage (dont certains viennent de sortir en DVD).
Apparition/disparition, la déambulation de Camille/Carmen donne chair à un vers de Cortazar, dans son Crépuscule d'automne, qui ira sans doute comme un gant au film tout entier terminé: «Tout surgit de la nuit, background inévitable». En ces temps compliqués, où l'on dit la jeunesse sacrifiée, il resterait donc le cinéma pour contrer le marasme ambiant. Les Amants de Low Life, en cours de montage, sortira en salles courant 2011.
© Collectif ITEM
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Chouette que tu aies pu les récupérer, ces textes. Je vais lire ça. 

lorinlouis- Messages : 1691
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Low Life
Low Life de Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval
Cinéaste à la marge du centre et au centre de la marge, Nicolas Klotz séduit et mécontente une fois de plus. À Locarno, son dernier film s'est fait aimer (la musique, notamment, fait l'unanimité – son titre d’ailleurs repris à New Order), mais non sans réserves. Low Life ne cesse d’avancer entre sourdine et trompette. Résultat : les uns n'écoutent que la sourdine, les autres que la trompette. Il y est question d'un papier (un décret d'expulsion) ensorcelé par des pratiques vaudou. Le papier (comme le film) brûle à la tiède température de notre époque.
L'erreur serait d'aborder Low Life par son propos politique, son côté le plus évident et le plus mystérieux. Discours qui mélange sans gêne des notes aussi diverses que la poésie d'Hörlderlin et la philosophie de Nancy et se déclame comme un mantra, via la bouche de jeunes héros aux allures bressoniennes. Ce mantra est en vérité un simple chant d'oiseaux. Une histoire d'amour structure le film ; on ne pourrait pas en imaginer de plus conventionnelle : lui, elle et l'autre. Charles et Carmen militent dans un réseau underground. Elle s'éloigne de lui et rencontre un jeune poète afghan menacé d'expulsion, Djamel. Lorsque ce dernier échappe à un contrôle de police, elle décide de l'enfermer dans sa chambre. À jamais.
L'alliance entre lutte amoureuse et lutte politique est, on le sait, la planche pourrie du cinéma français. On s'y appuie pour trouver une histoire, un mouvement, une dramaturgie et finalement on tombe toujours sur une morale de poche : tu trahis ta classe ou tu en es prisonnier ? Ce qui est une manière, au cinéma, de transformer les personnages en cas ; et les cas, disait Daney, on ne les aime pas, on s'y penche. Klotz danse dangereusement sur cette planche. Et quand elle commence à craquer, il tape carrément du pied. La sociologie enrobe la bande et notamment Charles de détails concernant ses revenus où, avec un peu de malice, on peut lire une vanne envoyée à certains cinéastes indépendents. C’est pourquoi ce qui sauve définitivement le film est l'idée de faire de Carmen un personnage absolument asocial. Lorsqu'un inspecteur de police, une femme androgyne aux allure de chef d’entreprise, l'accuse de violer la loi de la société, elle ne conteste pas cette loi et ses raisons, elle lui oppose une autre, celle du coeur qui dépasse la première en nature et qualité. C'est naïf ? C'est pompeux ? C'est Antigone ? Pour sûr, ce n'est pas Agamben. Cette fille, qui a le regard têtu de sa jeunesse n'est pas un ange, n'est pas là pour annoncer quoi que ce soit, surtout pas la révolution qui vient. C'est plutôt une bonne nouvelle, on en avait marre d'attendre.
Eugenio Renzi
http://www.independencia.fr/FESTIVALS/LOCARNO_2011_2.html
Même si c'est plus "mesuré" que sa critique de "Vénus Noire", ça arrive presque (plus insidieusement) à dégouter de regarder le film.
Invité- Invité
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Le papier (comme le film) brûle à la tiède température de notre époque.
Je ne sais pas à quelle époque le mec vit mais certainement pas à celle de la plupart des gens ; tiède l’époque? mais qu'il aille faire un tour, dans les pays chauds, en Syrie, en Egypte, en Libye , ou dans la corne de l’Afrique, ou dans des coins plus proches, dans les quartier où l’on mène des low life sans nécessairement écouter new order ; il verra que c’est pas si tiède que ça, notre époque ; à moins que le mec ne considère pas ça comme son époque, à moins qu’il ne soit d’une autre époque, ou ne considère sa petite vie, assez tiède en ce moment, comme la mesure de l’époque; là on peut comprendre, et il aurait suffit qu’il dise simplement, « l’époque brûle à la tiède température de ma vie « ; et que répondre à ça? pas grand-chose, quelque chose de biblique, peut-être : parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, nous allons te vomir de notre bouche.
Discours qui mélange sans gêne des notes aussi diverses que la poésie d'Hörlderlin et la philosophie de Nancy
Curieux, qu’il trouve ça aussi divers, hölderlin et Nancy… en lisant ça, on a le sentiment que nancy n’a jamais entendu parler de Hölderlin, à moins que ce ne soit renzi qui n’a jamais entendu parler ni de nancy ni de hölderlin, ou alors uniquement dans des soirées « new order »
L'alliance entre lutte amoureuse et lutte politique est, on le sait, la planche pourrie du cinéma français.
assez marrant
transformer les personnages en cas ; et les cas, disait Daney, on ne les aime pas, on s'y penche.
Sans doute, mais à l’époque de daney on s’y penchait pas sur les cas, on se penchait sur eux; la preuve :
« Le drogué - surtout l'enfant qui se drogue - ce n'est pas un personnage, c'est un cas. On ne s'intéresse pas à un cas, on se penche sur lui. »
(daney)
notons que le mec veut aimer, là où daney voulait juste s'intéresser
La suite est du même ton

Borges- Messages : 6044
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
The French have a way with films about disaffected youth, a style that is manifestly different from their American counterparts. Consider a few of the great French classics: Jean Eustache’s La maman et la putain, Jean-Luc Godard’s Masculin féminin and La chinoise, Philippe Garrel’s Les amantsréguliers, Robert Bresson’s Le diable probablement. They are all poetic, metaphysical, existential and self-conscious. Co-directors Nicolas Klotz and Elisabeth Perceval have imbibed and digested this tradition into the marvelously effective Low Life.
Setting their tale amidst the squats of Lyon, the film revolves around a group of disenchanted, mildly rebellious youths who could easily be modern-day versions of Rimbaud and Verlaine or Sartre and Beauvoir. Their concerns are both immediate (they protest the forced eviction of a group of squatters and get caught up in the issue of illegal immigrants) and abstract (love, poetry and philosophy are the beats to which this particular group moves). The languid, mesmerizing Carmen (Camille Rutherford) is struggling to resolve her feelings for her present lover, but soon finds herself falling in love with a passionate Afghani student. Both are poets, and indeed much of the film’s discourse is not conversational; verse and studied theatricality replace idle chit-chat. This gives the film a unique, other-worldly tone that exquisitely matches the hermetic, claustrophobic feel of many of its situations and locations.
As Klotz and Perceval’s tormented lovers part and find each other, the film gathers in focus and intensity. Carmen’s Afghan lover is an illegal, and harbouring him only provides a short-term solution. Featuring a brilliantly imagined score and “stolen texts” from a bevy of writers (Artaud, Rilke, Bresson, Muller, Machado, Blanchot, Bailly), Low Life mines a vein of French cinematic thinking in dazzling fashion.
http://tiff.net/filmsandschedules/tiff/2011/lowlife

lorinlouis- Messages : 1691
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Il y a là plus de pensée, de sensible et de cinéma que dans les petits gribouillis de IndépendenCIA
Robert- Messages : 9
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
“Two types of film: those that employ the resources of the theatre (actors, directors, etc…) and use the camera in order to reproduce; those that employ the resources of cinematography and use the camera to create.” —Robert Bresson, Notes sur le Cinématographe
“Art is like a fire; it is born out of what it burns.”—Jean-Luc Godard, JLG/JLG
Mining the proverbial depths of despair is a romantic mainstay of artistic production, period. In the cinema, Béla Tarr has mastered miserabilism (for better and for worse) and as much as we want and expect another great film from the dour Hungarian, The Turin Horse does appear to be a likely last outing in a “Where do we go from here?” equation. That Nietzsche served as fodder makes Tarr’s last film pronouncement all the more believable, accompanied by howling winds strong enough to annihilate society as a whole and a single boiled potato for our meagre Last Supper. Yet, pessimism by way of contemporary philosophy (itself of the pessimistic persuasion) is more of a French specialty, especially when contemporaneity is wracked with repressive guilt and the spectres of a sodden history, the trespasses of the Occupation never distant. An interesting comparative study could be made between Godard’s Film socialisme (2010), with its veneer of essayistic opacity and its playful irreverence toward its own enjeux, and Nicolas Klotz and Elizabeth Perceval’s Low Life, a stylized, neo-gothic nocturne with traces of trance and a healthy dose of soixante-huitard nostalgia. The former has a significant cameo by Alain Badiou, while the latter quotes him and a host of other philosophers and writers in a pseudo-Nouvelle Vague (1990) literariness of fragmented, floating citations and abstracted monologues.
Godard may have been kidding when he suggested that his preferred method of dissemination for his latest film was to send teenagers out in a hot air balloon and have them land randomly with copies in hand. But the implication was clear: that the cinema should function as an intimate and meaningful encounter with individuals, not as a mass block (or a block of mass), that the space of discourse needed in today’s world is rarely accorded. Klotz and Perceval have, in some ways, enacted this scenario by engaging in a socially aware cinema from the ground up. Profoundly philosophical—Agamben, the philosopher also known for his cameo in Pasolini’s The Gospel According to Saint Matthew (1964), was the driving spirit behind their last film, La question humaine (2007)—their films harbour the influence of their peers, such as the prolific art historian Georges Didi-Huberman, with whom they have conducted workshops and pre- and post-film discussions. That “pre” is not prior to projection, but prior to shooting. Field research has always been an integral part of the duo’s writing-filmmaking process; their longish gestation periods are spent on roving workshops and feedback sessions with (non-)actors, classrooms, and philosopher friends.
As was the case for their oddly beautiful and radical trilogy consisting of Paria (2000), La blessure (2004), and La question humaine, their latest film, Low Life—the first to bear both their names as director—grew out of theatrical exercises and collaborative research. In 2009, Klotz and Perceval held a residency at the controversial CENTQUATRE, an artist incubator in the former Pompes funèbres de Paris in the 19th arrondissement, a gorgeous, labyrinthine space consumed by closed-door artist studios, which also recently housed filmmaker Sylvain George, there to edit some of his Qu’ils réposent en révolte (figures de guerres)—reviewed and interviewed in the last issue of Cinema Scope and sharing in many of the duo’s concerns—and formidable young critics Antoine Thirion and Eugenio Renzi with their online journal Independencia, so titled after Raya Martin’s film. (Oh yes, and Tricky was there once too, with naked photos of himself posted to the concrete walls…)
Klotz and Perceval’s time there as artists-in-residence was spent researching and laying the groundwork for Low Life, a continuation of their political preoccupations and themes, such as a literal body politic (where carnality is carrier and transmitter of historical trauma, especially illegal bodies), language laden with aphoristic truisms, and disaffected and disenfranchised people, in this case les sans-papiers living in the underworld of Lyon. As a confused, communal group of young friends and lovers who largely live by night freely exchanging wine for café in the morning, ebb and flow between languorous existential musings, meaningful encounters, barricading illegal squats and revelling in an intoxicated haze, the film eludes its own present by conflating France’s pressing issue of the day—Sarkozy’s puerile and abhorrent approach to immigration—with a ‘60s-era verve for revolution. Cross-pollinating Bresson (Le diable probablement, 1977), Pedro Costa (In Vanda’s Room, 2000; Colossal Youth, 2006) and Philippe Garrel (Les amants réguliers, 2006) by way of Jacques Tourneur (I Walked with a Zombie, 1943), Jean Rouch (Les maîtres fous, 1955) and Peter Watkins’ ethos and obsession with a mediatized society, Low Life is surprisingly, perhaps even treacherously, original while steeped in myriad literary, philosophical, and cinephilic references.
It all begins with Antigone (yes, Straub-Huillet are couched in there too, in solidarity, but also because of Notre musique [2004]), barefooted and goldilocked as she ambles down a darkened street, her eyes wild with abandon and emitting an intensity vacillating between life and death. She’s bewitched by her text; the lines of desperation that she repeats are not hers alone, though she incarnates them as ferociously as if her life depended on it. A haunting preface: Low Life is a portrait of an ambling youth, entranced by today’s society, adrift in a world of undetermined ideology and whose value system exists far below the surface (hence the film’s title). Caught up in a sort of tropical malady and stoking the embers beneath their inherited ruins, these youths depend on love, as well as their impulse to mitigate against society’s injustices in order to combat the phantasms of emptiness, however naïve or altruistic. Proving Bresson’s dialectical statement about two types of film to be false (or, at least, too reductive), Klotz and Perceval adeptly use theatrical artifice in order to create rather than simply reproduce. Low Life is replete with bold facial close-ups and staid scenes that defy their own theatricality, that are raw, intimate, stylized, and disarmingly hungry despite their torpour. The film’s affectations are not dissimilar to those in Le diable probablement; in fact, the latter’s suicidal protagonist Charles and ecological clarion call are both subsumed in Low Life as a regenerated and regurgitated form of pessimism toward our contaminated present. (Bresson had said that he was pressed to make the film, which was infamously banned in France for incitement to suicide, because of “the mess we made of everything,” and “the shocking indifference of the people, except for certain young people of today, who are more lucid.”)
Bresson’s film is admittedly also about beauty—physical beauty, angelic and doomed. His Charles, with his long, straight hair and dreamy stare, is ethereal, not unlike Low Life’s Charles, who, spurned by his lover Carmen, drifts alone in a depressive state. As he listens to his iPod and perches on the base of a marble statue, his gaze turned upward and legs dangling below, the camera fixes him from a low angle, a heavenly, monumental sight to behold. (Whether or not we accord him gravitas is another matter.) Meanwhile Carmen, with her black, lacy clothes and sooty, big eyes, is an apparition from Nosferatu (1922) or an early Lang, a dark yet luminously expressionistic gamine. While protesting a raid on a squat, she meets and immediately becomes spellbound by Hussain, a magnetic Afghani poet who is studying in France illegally. Their affair is intense, fuelled by their bodies and their minds. “Poetry reminds me how things can be different,” says Carmen as she watches over Hussain, his looming deportation threatening to put an end to their consuming affair. He has seen what she has not, and it is his gaze, deep, sensible, and troubled, that has the power to heal. His thesis on Hölderlin’s silence attests to a silent civil war being waged, and to the gods haunting a mythic world: a world of voodoo and black magic that suffuses this clandestine life beneath society’s surface. There are many forces at work, conspiring, constricting, policing, inexplicable and unreal. Can love resist them all, or at all?
Before moving in with Carmen, Hussain was living in a squat filled with illegal African immigrants. A zombified teenager, Julio, was accorded Hussain’s room so that he could recuperate from an unknown sickness. Rounded up by police during a raid, he was taken to hospital where X-rays of his bones determined his age to be 18 years rather than the 15 years that he and his mother thought him to be, making him susceptible to legal expulsion. These tests and machines, bewitching and suspicious, have rendered him catatonic, brought under the spell of a militarized science. Surveillance, too, plays a large part in the film as the tracking of bodies evokes the horrors of the past, ostensibly leading back to the Occupation. The loss of self in society as a result of mass corporatization, combined with the crackdown on immigration, has resulted in a land of living dead. If the mind cannot resist, can bodies do so? Hussain shaves his head, not as a sign of madness, but of strength and wanting to be naked in front of the woman he loves; he shaves her sex in return as a gesture of intimacy. A raw and startlingly guttural flamenco performance early on in the film captivates Charles’ attention, providing a jolt to his catatonic malaise. A clubby dance scene (virtually a prerequisite in contemporary French cinema; remember the utterly astonishing rave sequence with Mathieu Amalric in La question humaine, or Monica Bellucci’s steamy dirty dancing in Garrel’s hot-coloured and -blooded Un été brûlant) which begins with a harsh cut to a medium shot of a DJ sporting headphones and singing a haunting air into a microphone, allows and calls for ultimate release: bodies moving, sentient, seeking freedom, expression, and sex.
Just as its characters ebb and flow, so too does the film between a feverish sense of paralysis and a mounting fervour, sometimes clenched and awkward, or strangely unfettered. With its heavy, wafting non-diegetic use of original music composed by Klotz and Perceval’s son Ulysse (somewhat evocative of Joy Division and its brooding ilk), its laden and literary dialogues, and its bursts of startling images—such as a closetful of squatting children with their faces covered in glow-in-the-dark paint, or Julio perfectly positioned in front of an empty blue wall—Low Life is a trance, burnished-coloured zombie film as if painted by Manet (the flamenco dancer could have been one of the painter’s subjects in a previous lifetime), a film that boldly confronts a gunmetal dystopian present-day future, cold and dehumanized with an amber, velvety texture. Distortion between words and images is reminiscent of Tourneur’s moody use of music and environment; in addition to his I Walked with a Zombie, Klotz and Perceval used Victor Halperin’s White Zombie (1931) and Todd Browning’s Dracula (1932) as pre-production referents. Unlike the zombification in Chantal Akerman’s latest, La folie d’Almayer, based on Joseph Conrad’s first novel and starring an actorly Stanislas Mehrer who is barely surviving in his opium fog, the living dead of Low Life engender disquiet but also great empathy for their attempts to see clearly despite all the cruelty and confusion. Akerman is a master of madness, while Klotz and Perceval posit a tertiary space somewhere between reality and rationality. Their mannerist mortification won’t be for everyone; Low Life mixes documentary desire with an unbridled romance (the French Romanesque is more apt here) that takes off from La maman et la putain (1973) and veers into highbrow theoretical territory. It’s a fascinating, dissonant, and exceedingly idiosyncratic (both gutsy and presumptuous) approach to the infernal hemorrhaging of society. When a death spell is cast upon expulsion papers, that death comes swiftly and defies toutes les règles du jeu.
http://cinema-scope.com/wordpress/cs-online/tiff-countdown-1-low-life-388-arletta-avenue-back-to-stay-elena-the-forgiveness-of-blood-good-bye-gypsy-leave-it-on-the-floor-mr-tree-the-patron-saints-sleeping-beauty-smuggle/

lorinlouis- Messages : 1691
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Toronto International Film Festival 2011: Low Life and Almayer's Folly
BY PHIL COLDIRON ON SEPTEMBER 16TH, 2011 AT 1:38 PM IN FESTIVALS, FILM
"…and may they hurry up, abandon the horrendous classist denomination of students and become young intellectuals…"—Pier Paolo Pasolini, "Apology"
If immigration has turned out to be the festival's de facto theme, then surely Nicolas Klotz and Elizabeth Percival's Low Life must be the film of the festival (though not of the year, that goes to Bertrand Bonello's staggering House of Tolerance). A film that's nearly as unfashionably direct in its romance and politics as Philippe Garrel's That Summer, Low Life is many things—a study of the struggle of bourgeois youths to truly engage in revolutionary activity, a catalogue of the terrors wrought by Nicolas Sarkozy's idiotic national identity, an excavation of the physical spaces where change must arise from, and a reminder that love and revolution are inextricable—and it does them all well.
Shot on the Canon 1D DSLR, the film's perpetual twilight evokes a space between the late films of Robert Bresson and Pedro Costa's digital works (logical: Klotz made a film in 2001 featuring Costa and Jean-Luc Nancy, whose influence also weighs heavily here), a painterly light that makes thrilling use of grays, browns, and oranges in envisioning a world tangential to our own, one where the failure of revolution is not viewed as a foregone conclusion. Klotz, who handles the pair's visuals (Percival handles writing and the direction of the actors, most of them here nonprofessionals), conceives every domestic space as hidden—quite literally: a labyrinthine squatters' den and a concealed room in a student apartment—refuges from the world of perpetual conflict that burns outside. This burrowed in spatial sense compliments the numerous layers of Percival's highly allusive script, which moves from a wide angle view of the total student-immigrant-police situation in to a close-up of two student lovers, Carmen (Camille Rutherford) and sans papiers Hussain (Arash Naimian).
Low Life opens with a tertiary character reciting lines from a depressive Ophelia in Heinrich Müller's Hamletmachine (a reworking of Shakespeare's text into a democratic mechanism for producing multiple, equal versions of the play), serving the double purpose of establishing the romantic tone and limning its political thought, a Straubian commitment to looking back rather than slavishly progressing. It climaxes, in a fitting contrast, in an interrogation room at the hypermodern headquarters of the Lyon police, a sleek space choking in visual information: Charlotte first is made to watch surveillance footage capturing her with Hussain in an effort to coerce her to turn him in (she responds bravely by turning to the past, invoking Vichy's actions toward the Jews in a chilling parallel with Sarkozy's attitude toward immigration), and we then see her in a holding cell viewed across six staggered monitors, an Eisensteinian decomposition of movement creeping in and hacking away at the unity of the State's vision.
Klotz and Percival have created a film that seems impossible to even conceive of in America today, one that truly believes in the desire of youth to alter history for the better. In the end, Hussain and Charlotte both must disappear for their love; perhaps they cannot be together now, but the resistance will live in each of them. The hope of a brighter day remains.
For her first narrative feature in seven years, Almayer's Folly, Chantal Akerman has returned to a classic author of modern literature, though her treatment of Joseph Conrad is far less loving than her treatment of Proust: She bluntly refuses to film his novel. A kaleidoscopic, compact portrait of one white man's insanity among the pratfalls of colonial life in the South Pacific, Conrad's novel ends with a sudden, arbitrary absolution for its pitiful protagonist; Akerman shares none of Conrad's concerns, and treats the text as a stock from which to pull names, images, and narrative threads in order to weave them into a Denisian tapestry—though unlike Denis, the focus is less on the unraveling of the fabric than on studying the emotional-political forces that arrange the strands into this particular pattern. The guiding idea is a reversal of Conrad's imperialist and sexist tendencies, one that does not seek to put Akerman in Conrad's position, but to create a fluid vision of the decay of empire in which the same forces that drive imperialism are laid bare to show how sorely they lack on the human level.
The opening, a grand coup de cinema, is not only thrillingly seductive, it sets up the film's structural acknowledgement of the presence of a source text that it will deny at every turn: In a scene entirely invented by Akerman, a man walks through a garishly neon nightclub, watches a cheesy lounge singer, and then murders him; after an off-screen voice whispers, "Nina, Dain's dead," one of the performer's backup dancers—later revealed as Nina Almayer, the dead man revealed as her lover, Dain—steps forward and calmly, beautifully performs Mozart's setting of the "Ave Verum Corpus". With this simple scene one senses both the presence of an interior intelligence prodding events along lines loosely related to Conrad's text (here, the names only) and the film's self-awareness of its position of opposition to Conrad: where the novel ends with Nina throwing herself into a situation with Dain that can only end badly in order to escape an even worse one with her father, Kaspar Almayer, the film begins with a confirmation that the death of her lover will do nothing to lessen her capacity to live a beautiful life.
Akerman continues along these oppositional lines, frequently pushing the action so deep into foliage or darkness that the film ceases to have any relation to the novel at all and becomes a pure study in its fetid, feverish landscapes. Where La Captive used a taut, dynamic camera to craft a level of Hitchcockian precision that Akerman used to carve into Proust's memory, here the effect of her numerous tracks is closer to Alain Resnais in the '70s: a tool for maintaining a continuity across multiple times, spaces, and registers in order to draw a full picture that is strictly cinematic.
When, in the final shot, the camera settles on the face of Stanislas Merhar's Almayer for what must be five minutes but feels like eternity, Akerman, totally eschewing judgment, achieves something nearly on par with the closing shot of Jeanne Dielman: Here there's a pure expression of a life fallen apart and the realization that an entire way of looking at the world has been defeated. In sum, a confirmation of a postulation by today's least literary director: Cinema can be an avenger.
Low Life and Almayer's Folly @ the Toronto International Film Festival
http://www.slantmagazine.com/house/2011/09/toronto-international-film-festival-2011-low-life-and-almayers-folly/

lorinlouis- Messages : 1691
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Locarno 2011
According to Le Film Francais, Locarno took place this year “under the sign” of French and American cinema, but three films apiece out of twenty in the International Competition hardly amounts to a takeover. The implication could be that, in his second year as artistic director, Olivier Père (former Directors’s Fortnight supremo) has bought Cannes’ time-honoured formula of celebrity and cinephilia to bear on the Swiss festival. With Harrison Ford, Daniel Craig and Gérard Depardieu passing through, there was a discernible upping of star-power, and the influence of classic French cinephilia remains evident in the Retrospective section: Minelli this year, Lubitsch last time. Who’s up next, I wonder?
Two of the French titles in Competition stood out for defiant singularity, bordering on the unclassifiable. I’m still trying to figure out Rabah Ameur-Zaimeche’s Smugglers’ Songs. Is it an 18th century French oater? A political parable about a clandestine life led in the margins of a revolutionary moment? It’s both of these and, in the tradition of the western, opts to ‘print the legend’ of the outlaw Louis Mandrin, a French Robin Hood executed by the Ancien Régime for smuggling. Ameur-Zaimeche doesn’t so much recount Mandrin’s story as follow in the footsteps of a band of former associates who aim to keep his rebel example alive by distributing printed copies of songs glorifying his exploits. This indirect, after-the-fact approach is enhanced by a telling use of anachronisms, with French North African actors playing the smugglers (Ameur-Zaimeche himself features as the leader of the gang). Thus declaring itself a historical drama that incorporates a critique of its own method, Smugglers Songs works at the gap between reconstruction and re-enactment, and the different visions of history implied in each: the former freezing the past in fetishistic detail, the latter bringing events alive in the present. But there’s nothing aridly meta here, the film remains grounded in a evocative sense of Provencal landscapes (shot with painterly care by Irina Lubtchansky), lavishes attention where due on the period detail of musical instruments and printing presses (philosopher Jean Luc Nancy pops up as an Enlightenment-friendly publisher), and proceeds with an overall lightness of touch (enhanced by the arch presence of French director Jacques Nolot as a sympathetic local aristocrat) that makes for an oddly charming experience.
Charms of a more occult kind are at work in Low Life, a supernatural-political love story by director-writer duo Nicolas Klotz and Elizabeth Perceval. Carmen (Camille Rutherford), a young student, falls for Hussain (Arash Naimian), an Afghan refugee who’s refused asylum and it’s around the resulting love triangle, involving Carmen’s ex-boyfriend, that the filmmakers weave an ambitious, otherworldly piece of cinema. With its voodoo rites and Tourneur-esque mood of possession, Low Life takes the uncanny atmosphere of their art-house hit Heartbeat Detector (07) and amplifies it into the film’s resonant bass note. The core of political horror that haunts the film concerns the treatment meted out to illegal immigrants by the French state, which is seen to recall the Vichy regime’s round-up of Jews, and when expulsion orders are issued (dubbed ‘death sentences’ by those on the receiving end) the film truly hits its stride in an extended hallucinatory sequence which mesmerised the audience I was in. From Cocteau to Garrel, there’s long been an intensely oneiric strain to French cinéma fantastique, of which Low Life is a powerful example. But what’s unique about Klotz and Perceval is how they succeed in combining this with fierce political intent. It won’t convince everybody but it put a spell on me.
The most anticipated American film in competition was Julia Loktev’s The Loneliest Planet, with its promising pairing of Gael Garcia Bernal and Israeli actress Hani Furstenberg as Alex and Nica, a pair of young Americans experiencing relationship stress while trekking in the Caucasus. The pairing might have looked good on paper but onscreen they’re outshone by Georgia’s top mountaineer, Bidzina Gujabidze, a non-professional actor who plays their guide Dato with lugubrious charisma. Loktev is evidently fascinated by her two stars but allows them far too much scope to moon about inconsequentially against stunning mountainous vistas and hence fail to engage the audience for long stretches. When a tangible threat prompts an ambiguous reaction from Alex it seems that the outside world might finally intrude, but the consequences are thrown away with off-handed bathos that disproves the old adage that short stories make for better films than novels (the film is adapted from a Tom Bissell story).
Loktev might be said to be working in the mode of festival filmmaking that the Brothers Dardenne inaugurated with Rosetta (99). Let’s call it ‘pedestrian realism’, in the sense that the filmmaker sticks close to a character as he or she footslogs it through the film’s terrain. It’s just that more accomplished takes on the genre than Loktev’s were also in competition, such as Massimiliano and Gianluca De Serio’s Seven Acts of Mercy, which follows – literally, and almost wordlessly – a young female immigrant in Italy acceding to a state of grace through various trials on an ironic if unapologetically Christian itinerary. Similarly, Sebastian Lelio’s Year of the Tiger unremittingly tracks its protagonist, an escaped prisoner voyaging through the disaster zone of the 2010 Chilean earthquake, but drab digital cinematography lets down an intriguing premise.
A final word about a small masterpiece. Screened out of competition, Jose Luis Guerin’s Memories of a Morning is one of three mid-length films commissioned by the Jeonju Festival’s ‘Digital Project’ (the others are by Claire Denis and Jean-Marie Straub). And while I understand that it owes something to Guerin’s feature length Work in Progress (01) – which I haven’t yet seen – Memories stands alone as a multum in parvo masterclass. From the simplest elements – light falling on a wall, a Bach partita, a subtitle from Proust, and the recollections of the filmmaker’s neighbours on a Barcelona street corner where a violinist named Manel jumped from a window and killed himself years before – Guerin constructs a beautiful meditation on life, death and the power of art. Attention: when it comes to the essay-film there’s another JLG in town!
Chris Darke – FILM COMMENT
Top Ten
Low Life
(Nicolas Klotz & Elizabeth Perceval, France)
Memories of a Morning
(José Luis Guerin, Spain)
Smugglers’ Songs
(Rabah Ameur-Zaimeche, France)
Seven Acts of Mercy
(Gianluca & Massimiliano De Serio, Italy)
Nana
(Valérie Massadin, France)
Policeman
(Nadav Lapid, Israel)
Giacomo’s Summer
(Alessandro Comodin, Italy)
Special Flight
(Fernand Melgar, Switzerland)
Goodbye First Love
(Mia Hansen-Love, France)
Back to Stay
(Milagros Mumenthaler, Argentina)

lorinlouis- Messages : 1691
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Beaucoup aimé le film.
Je suis sidéré de lire ce que je lis, dans les critiques de Libé, Cahiers, Critikat, Chronicart, etc. La posture de surplomb des critiques, à qui on ne la fait pas, est invraisemblable, et tous, avec ou plus de moins de morgue, finissent par conclure que le film est tellement "ridicule" qu'il en devient intéressant.
"Ridicule", c'est le mot qui revient le plus : ridicule cet amour du texte et de la poésie. Ridicule de comparer les flics aux chiens de Pétain. Ridicule cette vision d'une société vidéosurveillée. Ridicule cette théâtralité. Ridicule le romantisme. Ridicule de s'engager pour empêcher des expulsions de sans-papiers. Ridicule cette idée qu'un film puisse tenir un discours.
C'est bien simple : tout ce qui fait que ce monde a de l'intérêt, tout ce qui brûle un peu, ces types trouvent ça "ridicule". Je peux pas croire qu'ils aiment vraiment les films de Bresson, de Garrel, de Godard, comme ils le prétendent par ailleurs, pour écraser le film.
Essentiellement, ce qu'ils reprochent au film, c'est d'être bavard, d'être affecté, pas incarné, de citer Hölderlin, Badiou, Didi-Huberman, alors que ça se fait pas au cinéma.
Mais à mon avis, c'est pas que le film tienne un discours qui les dérange : c'est que le film tienne ce discours, tienne le discours qu'il tient, qu'ils ne supportent pas. Ils supportent pas d'entendre dire au cinéma que les flics qui évacuent les squats sont des chiens, les chiens de Pétain, que les super flics sont pas différents des fachos d'antan ; ils supportent pas d'entendre de la poésie.
Parce que, n'est-ce pas, la réalité est tellement "plus complexe", plus "ambiguë". Faut vraiment être un "bobo de gauche", un "grand-père soixante-huitard" pour y croire encore, à ces vieilles lunes (j'invente rien : tout ça est dit texto).
La palme revient aux Cahiers, mais j'ai la flemme de retaper leurs âneries condescendantes.
Derrière, il y a Critikat. Dans la série "Je fais une fleur à ce film en daignant en parler", le type commence comme ça :
Dans la catégorie "Pour en finir avec la pensée 68", on lira ceci :
Je suis sidéré de lire ce que je lis, dans les critiques de Libé, Cahiers, Critikat, Chronicart, etc. La posture de surplomb des critiques, à qui on ne la fait pas, est invraisemblable, et tous, avec ou plus de moins de morgue, finissent par conclure que le film est tellement "ridicule" qu'il en devient intéressant.
"Ridicule", c'est le mot qui revient le plus : ridicule cet amour du texte et de la poésie. Ridicule de comparer les flics aux chiens de Pétain. Ridicule cette vision d'une société vidéosurveillée. Ridicule cette théâtralité. Ridicule le romantisme. Ridicule de s'engager pour empêcher des expulsions de sans-papiers. Ridicule cette idée qu'un film puisse tenir un discours.
C'est bien simple : tout ce qui fait que ce monde a de l'intérêt, tout ce qui brûle un peu, ces types trouvent ça "ridicule". Je peux pas croire qu'ils aiment vraiment les films de Bresson, de Garrel, de Godard, comme ils le prétendent par ailleurs, pour écraser le film.
Essentiellement, ce qu'ils reprochent au film, c'est d'être bavard, d'être affecté, pas incarné, de citer Hölderlin, Badiou, Didi-Huberman, alors que ça se fait pas au cinéma.
Mais à mon avis, c'est pas que le film tienne un discours qui les dérange : c'est que le film tienne ce discours, tienne le discours qu'il tient, qu'ils ne supportent pas. Ils supportent pas d'entendre dire au cinéma que les flics qui évacuent les squats sont des chiens, les chiens de Pétain, que les super flics sont pas différents des fachos d'antan ; ils supportent pas d'entendre de la poésie.
Parce que, n'est-ce pas, la réalité est tellement "plus complexe", plus "ambiguë". Faut vraiment être un "bobo de gauche", un "grand-père soixante-huitard" pour y croire encore, à ces vieilles lunes (j'invente rien : tout ça est dit texto).
La palme revient aux Cahiers, mais j'ai la flemme de retaper leurs âneries condescendantes.
Derrière, il y a Critikat. Dans la série "Je fais une fleur à ce film en daignant en parler", le type commence comme ça :
Vous comprenez, il est "catastrophé" : c'est une nouvelle catégorie, à écrire en italique : la critique catastrophée. Ca consiste à rabaisser le film tellement bas que quand nous faisons mine de nous abaisser vers lui, le film nous accueille avec reconnaissance et gratitude, devant tant de suave bienveillance. Et c'est tout de même hyper-gratifiant pour nous autres, les critiques catastrophés, de nous voir si magnanimes, si pleins de considération pour une si petite chose. Le Ciel nous le rendra, assurément.Les films in-sauvables ont en commun avec les dits « chefs-d’œuvre » de mettre à l’épreuve la critique : il faut les sauver à tout prix de leur éloignement altier, quitte, paradoxalement, à leur rendre la vie en tirant (par charité) sur l’ambulance. Problème du « quoi (en) tirer », hésitation entre faire les poubelles (fouiller et refouiller jusque dans l’inconscient du film, du réalisateur, voire du dossier de presse), ou rajouter en douce un peu de corps (comme on rattrape une viande douteuse par un fond de sauce ou des épices).
En outre, aucun désir ni de descendre ce film (exercice ennuyeux), et impossibilité de le défendre. C’est peut-être à la lisière de ces deux positions que se tient celle du catastrophé. Une posture raide d’observateur, tentant de lier avec un objet-événement qui le dépasse un semblant de relation.
Dans la catégorie "Pour en finir avec la pensée 68", on lira ceci :
On apprend, en note, que le critique catastrophé prépare une thèse sur Daney critique. Ciel ! Ce pauvre Daney qui osait écrire qu'une Occupation continue tant qu'on met "Les Enfants du Paradis" au pinacle... Espérons que sa thèse remettra un peu de complexité et d'ambiguïté dans tous ces jugements simplistes d'une autre époque.Amour et engagement, sensibilités « d’artistes » (elle est photographe, il est poète) contre un monde contemporain dit cruel et machinique : il y a dans Low Life un appel aux poncifs qui étourdit. Les énumérer serait fastidieux, et ils sont nombreux. Contentons-nous pour l’instant de mentionner, en exemple, la fin du film : interpellée parce qu’elle cache Hussain, Carmen se retrouve dans une cellule remplie d’écrans vidéos (la police surveille tout), face à ce qui semble être la dirigeante de l’opération (Hélène Fillières). Cette dernière est coiffée « à la nazi » : cheveux blonds plaqués, elle est sèche, terrible. Carmen, accusée d’avoir caché un sans-papier, se rebelle : « En 42, j’aurais fait pareil. » Superbe point Godwin. Aucune distance ne sera jamais prise. Elle aurait pu être historique : on se demande comment Klotz et Perceval, qui ont réellement vécu Mai 68, et devraient savoir ce que c’est que la matérialité d’une lutte et les dangers réels qu’elle comporte, peuvent reconduire à ce point une idéologie de gauche faiblarde, un ensemble de comportements qui relèvent du dandysme engagé, d’un maniérisme politique.
Klotz et Perceval aiment la jeunesse, et Low Life en est leur ode (« j’avais envie de filmer la jeunesse comme une puissance antique »). Un regard de grands-parents ex-soixante-huitards, sur des petits enfants en prise avec une « actualité ».
On expliquera au spectateur où est la guerre, lorsque au début du film une dizaine de policiers (un peu effrayés) tirent des fumigènes et s’en prennent à des manifestants aussi peu nombreux qu’eux, et tout aussi effrayés. Affrontement, violences, pourquoi pas. Mais l’engagement en reste là.
À qui peuvent s’adresser Klotz et Perceval ? À qui ce discours simpliste (que d’autres appelleraient « bobo de gauche ») est-il destiné ? Sans doute pas aux vrais engagés, ni aux sans-papiers. ... Low Life ne peut prétendre qu’à une morale de façade, peu crédible. Les « jeunes » (de nationalité française) se sentiront-ils concernés ? Ce sont bien les seuls qui peuvent l’être.

Eyquem- Messages : 3126
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
tu dis que tu as beaucoup aimé. tu pourfends la critique qui n'a pas aimé. mais donne envie de le voir !
Invité- Invité
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Je sais, slimfast, mais chaque chose en son temps.
Ce que je pourrais en dire, de toute façon, ne serait pas séparable de ce rejet quasi unanime, toujours argumenté de la même façon: les critiques ne disent pas : "ce film est mauvais", mais "pourquoi un tel film existe? comment peut-on faire ce film?"
Ce que je pourrais en dire, de toute façon, ne serait pas séparable de ce rejet quasi unanime, toujours argumenté de la même façon: les critiques ne disent pas : "ce film est mauvais", mais "pourquoi un tel film existe? comment peut-on faire ce film?"

Eyquem- Messages : 3126
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Oui, le film est aussi mal accueilli par la critique que par le public (a priori moins de 2 700 spectateurs en première semaine).
Un tel film va manifestement complètement à contre-courant de l'esprit de son temps... Une jeunesse non seulement engagée (déjà c'est rare) mais qui en plus ne se contenterait pas d'une insurrection "citoyenne" à la Mélenchon, qui rêve d'une résistance totale, d'un mode de vie reposant sur ce fameux triumvirat art/amour/politique.
La poésie, la diction poétique (les personnages donnent souvent l'impression de déclamer leur texte), l'absence de toute forme de cynisme, d'ironie, de distance, c'est pareil. Pas dans l'air du temps. J'ai aimé le film, mais j'avoue avoir moi-même eu beaucoup de mal avec les poses affectées des personnages (particulièrement le jeune homme aux cheveux longs).
Low Life, c'est simplement l'antithèse absolue des filles de Letourneur.
Ce qui m'étonne tout de même, c'est que cette espèce de naïveté, de premier degré de l'engagement des personnages (les sentences du style "Pétain, reviens t'as oublié tes chiens" qui sont de grands classiques des manifs), et bien les critiques paresseux ont tôt fait de l'attribuer aux réalisateurs. Comme si le discours de certains protagonistes était nécessairement celui des auteurs.
Ces critiques regrettent certainement cette regrettable iniquité de traitement entre les flics et les jeunes. Ils préfèrent forcément Le Policier, qui dépeint les deux "camps" pour mieux les pousser dans leurs retranchements et leurs impasses.
Ca me fait penser, j'ai vu le film il y a un moment mais une scène m'a marqué : celle dans laquelle un policier blessé se fait soigner par les sans-papiers. Je me suis dit sur le coup, tiens, ils ont renversé les rôles de la scène de La Blessure. Je note ça en passant...
Un tel film va manifestement complètement à contre-courant de l'esprit de son temps... Une jeunesse non seulement engagée (déjà c'est rare) mais qui en plus ne se contenterait pas d'une insurrection "citoyenne" à la Mélenchon, qui rêve d'une résistance totale, d'un mode de vie reposant sur ce fameux triumvirat art/amour/politique.
La poésie, la diction poétique (les personnages donnent souvent l'impression de déclamer leur texte), l'absence de toute forme de cynisme, d'ironie, de distance, c'est pareil. Pas dans l'air du temps. J'ai aimé le film, mais j'avoue avoir moi-même eu beaucoup de mal avec les poses affectées des personnages (particulièrement le jeune homme aux cheveux longs).
Low Life, c'est simplement l'antithèse absolue des filles de Letourneur.
Ce qui m'étonne tout de même, c'est que cette espèce de naïveté, de premier degré de l'engagement des personnages (les sentences du style "Pétain, reviens t'as oublié tes chiens" qui sont de grands classiques des manifs), et bien les critiques paresseux ont tôt fait de l'attribuer aux réalisateurs. Comme si le discours de certains protagonistes était nécessairement celui des auteurs.
Ces critiques regrettent certainement cette regrettable iniquité de traitement entre les flics et les jeunes. Ils préfèrent forcément Le Policier, qui dépeint les deux "camps" pour mieux les pousser dans leurs retranchements et leurs impasses.
Ca me fait penser, j'ai vu le film il y a un moment mais une scène m'a marqué : celle dans laquelle un policier blessé se fait soigner par les sans-papiers. Je me suis dit sur le coup, tiens, ils ont renversé les rôles de la scène de La Blessure. Je note ça en passant...
 Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
Re: Low Life (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 2011)
ah merci voila du beau militantisme.

Invité- Invité
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5 
 Sujets similaires
Sujets similaires» Only God Forgives (Nicolas Winding Refn - 2013)
» Autour de "Collectif Ceremony" de Klotz et Perceval
» 200% (Nicolas Boone & Olivier Bosson - 2010)
» #2 - Traitement spécial de la langue (à propos de La Question humaine de Nicolas Klotz) par LorinLouis
» La société punitive (Cathy come home & Welfare...)
» Autour de "Collectif Ceremony" de Klotz et Perceval
» 200% (Nicolas Boone & Olivier Bosson - 2010)
» #2 - Traitement spécial de la langue (à propos de La Question humaine de Nicolas Klotz) par LorinLouis
» La société punitive (Cathy come home & Welfare...)
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 Accueil
Accueil